2137- Le compromis politique presque absent sous la Ve République 26 posts
Le Point a interrogé Jean Garrigues, historien spécialiste de la politique. Voici ses observations.
Le Point : La coalition Ensemble !, réunie autour du président Macron, a échoué à obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce cas de figure est-il historique ?
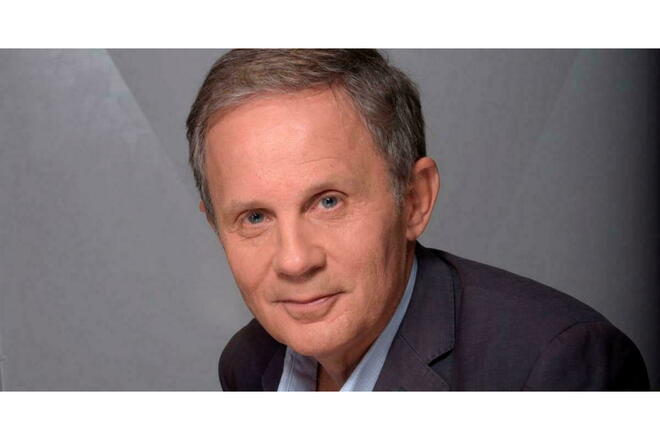
Les commentateurs politiques disent que l'Assemblée nationale sera « ingérable ». Qu'en pensez-vous ?
En principe, il n'y a pas de raison d'affirmer que l'Assemblée sera « ingérable ». Il est possible de gouverner avec une majorité relative. C'est d'ailleurs ce qu'a réussi à faire Michel Rocard en recourant au fameux 49.3, un article de la Constitution permettant de faire passer une loi sans l'approbation de l'Assemblée. Le Premier ministre d'alors l'avait utilisé 28 fois sur 15 textes. Il en est le recordman même s'il essayait d'abord de trouver des majorités alternatives sur tel ou tel texte.
Dans le contexte politique et social tendu que nous connaissons, imaginez-vous la Première ministre Élisabeth Borne y recourir pour faire passer ses lois ?
Pourquoi pas sur certains textes, comme les projets de loi de finances ou les lois concernant la Sécurité sociale. Le 49.3 n'est pas le seul instrument. Il existe d'autres méthodes pour gouverner sans majorité absolue. Je pense notamment à l'article 44 alinéa 3 de la Constitution française. Le gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer en un seul vote sur tout ou une partie d'un projet de loi. Cette procédure empêche les oppositions de déposer des milliers d'amendements afin de ralentir une loi. L'exécutif évite, par la même occasion, de voir son texte dénaturé par des modifications qu'il ne souhaite pas.
Quid de la recherche de majorité ponctuelle, au coup par coup, texte par texte ?
C'est une possibilité. Il est envisageable, sur certains projets de loi, de trouver une majorité en négociant soit avec les députés Les Républicains (LR), soit avec les députés socialistes et écologistes et, pourquoi pas, avec ceux du Rassemblement national (RN). Louis Aliot a dit qu'il est possible de négocier sur le pouvoir d'achat, par exemple.
Macron a exercé une présidence assez autoritaire et verticale.
Les partis politiques français ont-ils cette culture du compromis ?
La recherche d'une majorité d'idées à l'Assemblée n'est pas une tradition de la Ve République, alors que cela se pratiquait couramment dans le régime parlementaire de la IIIe République, notamment pendant l'entre-deux-guerres. Les partis au pouvoir n'avaient pas toujours la majorité absolue et recherchaient des alliances pour l'obtenir. Cette recherche du consensus s'est poursuivie de manière systémique sous la IVe République puisque la majorité était une coalition, appelée « troisième force ».
Pourquoi la France a-t-elle perdu cette culture du compromis ?
La logique des institutions de la Ve République, telle que conçue par le général de Gaulle, était de faire de l'Assemblée nationale le prolongement de la volonté présidentielle. Il voulait en finir avec le « régime des partis ». À ses yeux, la lente et incessante recherche de compromis – faute de majorité absolue – provoquait une forme d'immobilisme dans les réformes. Il a aussi voulu en finir avec l'instabilité gouvernementale, provoquée par le jeu des changements d'alliance. La logique gaullienne a donc prévalu tout au long de la Ve République. Elle s'est même durcie avec le président Macron. Il a exercé une présidence assez autoritaire et verticale. En plus de cette pratique du pouvoir, il a pu compter jusqu'ici sur une très forte majorité à l'Assemblée nationale.
Peut-on dire que la Ve République est contre-nature ?
La pratique de la Ve République, construite sur le rejet de la IIIe et la IVe République, n'est pas conforme à l'esprit du parlementarisme, tel qu'il a été conçu à partir de la Révolution française de 1789. À l'époque, on considérait que la logique du Parlement était de… parlementer. C'est-à-dire de discuter et de délibérer sur la loi pour la modifier ou la rejeter. Au cours de la IIIe République, l'interpellation du gouvernement par un député lambda pouvait conduire à un vote. Si ce vote mettait le gouvernement en minorité, celui-ci était renversé. On a perdu le goût et la vertu de la délibération et du contrôle parlementaire au profit de la cohérence et de l'efficacité gouvernementale.
Un retour à l'esprit de consensus vous paraît-il possible ?
Cela ne sera pas simple. Christian Jacob, le président du parti Les Républicains, s'est déjà dit hostile à un contrat de gouvernement… Autre obstacle, les deux principales forces d'opposition, à savoir le Rassemblement national et La France insoumise (LFI), sont des formations protestataires. Elles sont dans une opposition radicale au projet gouvernemental. Un retour à l'esprit de consensus exigerait une révolution culturelle, aussi bien de la part de l'exécutif que des oppositions. Emmanuel Macron et les partis d'opposition doivent montrer une véritable volonté de négocier. Pour l'heure, on en est loin. Mais pourquoi pas.
LFI, le PS, EELV et le PC ont su faire coalition, sur la base d'un programme commun, mettant de côté certains sujets qui fâchent. La Nupes a-t-elle cette culture du compromis ?
Je dirais que cette culture est d'abord inscrite dans les gènes du mouvement macroniste Ensemble !, coalition regroupant le parti présidentiel Renaissance et ses alliés MoDem et Horizons. Par ailleurs, quand on se décrit à droite et à gauche comme le fait Emmanuel Macron, c'est forcément que l'on tend vers des solutions de compromis. Problème : le président a peu utilisé cette dynamique de compromis, lui préférant l'autoritarisme.
De quoi Emmanuel Macron peut-il alors s'inspirer ?
Le tropisme du compromis, c'est le rapport de force. Dans le cas de la Nupes, le rapport de force était favorable à La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, lequel a imposé des directions politiques au PS, au PC et à EELV. Ainsi, pour Emmanuel Macron, la colonne vertébrale du projet gouvernemental doit rester celle d'Ensemble !, formation de loin majoritaire à l'Assemblée. Il lui reste à faire accepter ce rapport de force à ses éventuels partenaires, comme a réussi à le faire Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés de gauche.
Avec le scrutin proportionnel, on aurait pu se retrouver dans le cas d’une chambre vraiment ingouvernable.
Ce n'est pas gagné… Les Républicains, par exemple, estiment que les convergences devront se faire sur la base de leur programme…
Oui, c'est une mauvaise lecture du principe de consensus, preuve que le compromis politique est absent de la culture française. C'est très net : avec 245 députés, le rapport de force est à la faveur d'Ensemble !. Les discussions doivent donc se faire à partir du projet présidentiel et sûrement pas à partir du projet des Républicains et de leurs 74 députés.
Pendant la présidentielle, plusieurs candidats, dont Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se sont prononcés en faveur de la proportionnelle totale à l'Assemblée nationale. La nouvelle composition politique de la chambre haute exprime une très forte diversité. Est-ce un avant-goût ?
C'est vrai ! En dépit de la prime majoritaire, ce scrutin donne un résultat qui ressemble à la photographie des sensibilités politiques en France. Finalement, peut-être n'avons-nous pas besoin de la proportionnelle pour aller vers cette « adéquation démocratique ». J'ajouterai, cependant, qu'avec le scrutin proportionnel, on aurait pu se retrouver dans le cas d'une chambre vraiment ingouvernable, dans la mesure où Ensemble ! aurait obtenu bien moins de députés. En résumé, il n'y a pas de solution miracle. Avec le système gaullien semi-présidentielle, vous avez l'efficacité d'action du scrutin majoritaire. Avec la proportionnelle, vous avez l'équité démocratique.
